René
Valet
Baptême du 3 juin 1636 à
Saint-Nicolas de Saumur
Le lundy vingt troizieme jour de
juin mil six cens trente et six a dix heures du matin fut par nous
vicaire soubsigné baptisé René filz de Marie Valet et Renée Patot fut
parin Jehan le Roy chirurgien et Martine Marie Patot femme de Leonard
Moulinet tailleur d’habits
J Leroy
Marie Palot
Destray vicaire
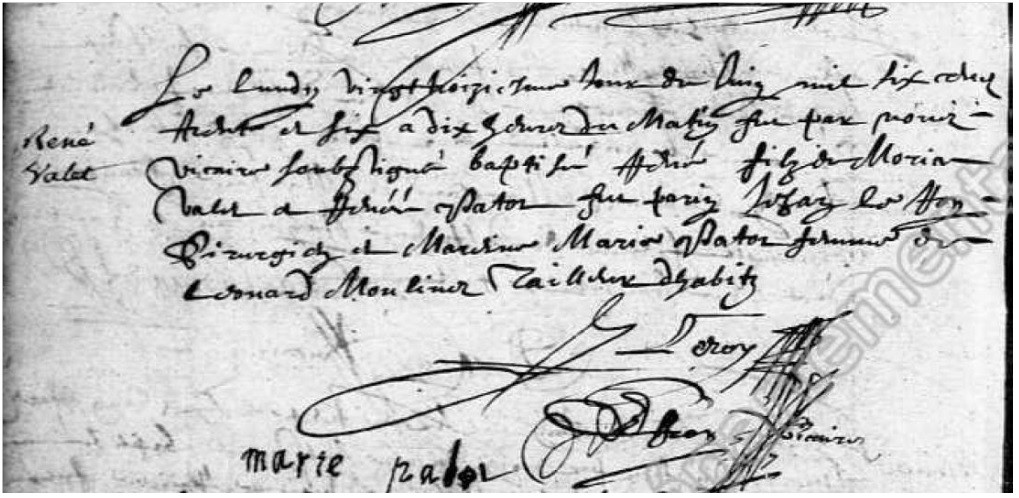
Son histoire :
Un armurier R. VALLET, originaire de Saumur ,(une ville protestante).Il est embauché Le 27mai 1661 il a 24 ans; par un investisseur négociant en fourrures et découvreur de nouvelle France, catholique lié aux Jésuites.
Médard Chouart Des Groseilliers dépossédé de ses peaux par le gouverneur du Québec en 1660 est revenu à la cour de France plaider auprès du Roi.
R. VALLET embarque le 15 juin 1661 à La Rochelle (protestante), sur le taureau armement protestant François Perron (d. c. d.en1665).
Il arrive à Québec le 24 Aout 1661 puis à destination à trois rivières en septembre. Un an après septembre 1662 il travaille pour la forge des jésuites alliés à son commanditaire.
En 1663 il rentre en France. Car :
-La Nouvelle France est désormais administrée par le Roi au détriment des « associés » mis a l’écart des affaires. Médard Chouart s’enfuit en Europe.
Cette année un grand tremblement de terre secoue la nouvelle France.(5 février 1663). Les villes côtières sont démolies en partie, leurs rivages emportés par les flots.
Le navire le Taureau repart en 1663 pour les Antilles. Il se peut que les événements politiques et telluriques ainsi que la perte de son commanditaire l’aient libéré de ses engagements. Il a peut être profité du retour du taureau vers La Rochelle.
On retrouve à Paris un armurier I. VALET (perte d’un L au nom) au début du XVIII éme siècle, créant une dynastie familiale dans l’armurerie. A l’époque un passage aux colonies facilitait l’acquisition de brevets professionnels. L’artisan pouvait cumuler les métiers et les qualifications.
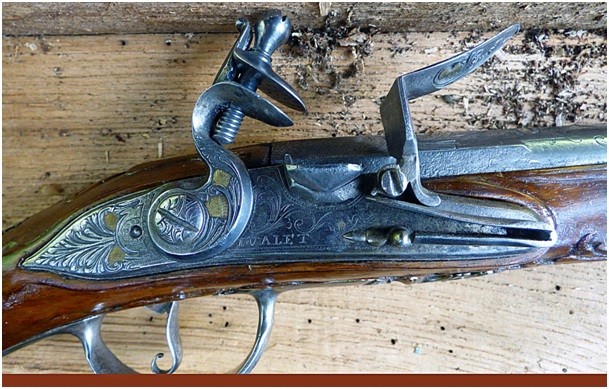
Notes historiques
Deux explorateurs passent au service des Anglais
La destruction de la Huronie et le massacre de plusieurs colons lors des
incessantes incursions iroquoises amènent la cessation presque complète
de la traite des fourrures. Ce commerce étant la seule exportation
d’importance de la Nouvelle-France on en vint alors à se demander s’il
ne fallait pas abandonner le pays. En 1654 la paix signée, les tribus de
l’Ouest arrivent à Trois-Rivières avec un grand stock de pelleteries.
Les Cris parlent d’une rivière fort spacieuse qui aboutit à une grande
mer (la baie d’Hudson).
En 1655
Médard CHOUART Des Groseilliers
et un compagnon demeuré inconnu, partent en voyage d’exploration au-delà
du lac Supérieur, là où se cachent des Iroquois : les Hurons et
les Outaouais. Ils reviennent l’année suivante chacun avec 14 à 15 mille
livres de pelleteries. Une flotte de sauvages les accompagne riches de
100 mille écus de fourrures. En 1659 Des
Groseilliers
et
Pierre-Esprit RADISSON
préparent une autre expédition pour les Grands Lacs. Le gouverneur
voulait qu’ils soient accompagnés d’un de ces hommes.
Des Groseilliers,
qui s’y oppose, s’esquive sans se faire remarquer. Les deux hommes
reviennent à Trois-Rivières le 24 août 1660 avec 300 Indiens. La Mère
Marie de l’Incarnation parle d’une flottille de canots, avec une
« manne céleste » de peaux de castors, et ajoute que cela allait sauver
la colonie de la ruine. Les Jésuites s’entretiennent avec
Des Groseilliers
pour connaître tous les détails du voyage et les consigner dans leurs
Relations. Trois Jésuites dont le père René MÉNARD et cinq
trafiquants repartent avec les Indiens qui rentraient chez eux.
À partir de cette année-là il y aura constamment des trafiquants
français qui iront dans l’Ouest. Ce voyage des deux explorateurs sauva
la colonie de la ruine économique et en préserva même probablement
l’existence selon l’historienne Grace Lee Nute. Ce qui n’empêcha pas le
gouverneur d’Argenson de saisir leurs pelleteries et de leur
imposer une amende pour être partis sans sa permission et de
jeter en prison
Des Groseilliers.
Ces avanies soulèvent la fureur des deux beaux-frères. Sitôt libéré
Des Groseilliers
s’embarque pour la France pour obtenir justice mais en vain. En
1662 à dessein ou par la force des circonstances ils abandonnent leur
projet d’un voyage d’exploration vers la baie d’Hudson à partir de l’île
Percée et se dirigent plutôt vers Boston. Il y sont mieux accueillis que
par leurs compatriotes. Ils passent à Londres en 1665 avec
Georges CARTWRIGHT.
En 1668 le roi met à leur disposition le vaisseau royal l’Eaglet,
et les armateurs un cotre, le
Nonsuch.
Des Groseilliers
fonde le fort Charles à la rivière Rupert.
*********
Sources :
Catalogue des immigrants, page 430. Trudel, Marcel; Dictionnaire
biographique du Canada en ligne, Médard CHOUART Des Groseilliers et
Pierre-Esprit RADISSON in http://www.biographi.ca/FR/index.html;
Relations des Jésuites, Journal des Jésuites, vol. 45, pages
156-164 in http://puffin.creighton.edu/jesuit/relations/
La vie de nos ancêtres à travers les documents d'archives… entre La
Rochelle et les colonies…
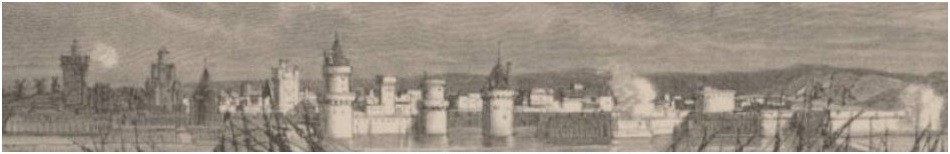
191 – L’expédition du navire Le Taureau pour le Canada en 1661
La flotte de 1661 à destination de Québec est composée de trois
navires : Le Saint-Pierre, Le Taureau et le navire de
Laurent Poulet. Deux autres navires sont destinés à l’île Percée :
La Marguerite (300 tx) et La Marie (400 tx)[1].
PHOTO 4
Malgré que la Compagnie de Normandie ait fait une intéressante marge de
profits en 1660, des mécontents tentent de l’éliminer. Selon Marcel
Trudel[2],
les trois navires de 1661 sont frétés par cette Compagnie, même si elle
est incertaine de son avenir.
Le 15 janvier 1661, une requête est présentée au roi dans le but de
faire annuler le traité de 1660[3].
En mars, le roi décide de maintenir ce traité, mais seulement en
attendant l’avis du nouveau gouverneur qui allait passer en
Nouvelle-France[4],
sur le navire Le Saint-Pierre.
Les préparatifs
Au printemps 1661, François Peron est sollicité par la Compagnie de
Normandie pour envoyer l’un de ses navires en Nouvelle-France. L’offre
est-elle si alléchante qu’il ne peut refuser ?
Quoiqu’il en soit, dans l’après-midi du vendredi 3 juin[5],
un contrat de charte-partie[6]
intervient entre Peron (¾) et Élie Tadourneau (¼), propriétaires du
navire Le Taureau (150 tx), et Pierre Fillye « l’un des commis
pour la négociation de Canada de Messieurs Rozée Guenet & Compagnie
[Compagnie de Normandie], marchands de Rouen. »
Ce contrat d’affrètement et de charte-partie stipule que Peron et
Tadourneau promettent recevoir à bord de leur navire, durant les huit
prochains jours :
-
60 à 70 passagers avec leurs coffres (à 60lt / passager);
-
40 à 50 tonneaux de marchandises (à 60lt le tonneau).
Ils seront tenus de nourrir les passagers pendant la traversée de La
Rochelle à Québec, sauf les périls et fortunes de la mer[7].
Il ne sera permis aucun passager ni aucune marchandise sans l’ordre de
Fillye. Ce dernier leur avance la somme de 1 500lt.
Somme toute, ce contrat est ni plus ni moins un contrat de location de
navire car, aussitôt arrivé à Québec, Tadourneau sera obligé de se
retirer sans y séjourner, ni même recevoir aucune pelleterie ou orignaux
« directement ou indirectement », à moins que Charles
Aubert
de La Chesnaye, l’autre commis de Rozée, Guenet et Compagnie, ou Pierre
Fillye, veuille mettre quelques pelleteries dans le navire pour le
retour. De plus, Tadourneau sera obligé de prendre jusqu’à deux ou trois
poinçons de castors pour les rendre à La Rochelle.
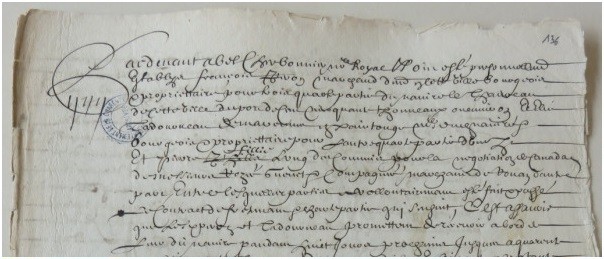
Extrait. Contrat de charte-partie prévoyant le passage de 60 à 70 passagers à bord du navire Le Taureau pour un voyage à Québec. 3 juin 1661.
(Source : AD17. Notaire Abel Cherbonnier. Liasse 3 E 1128)
Le 29 mars 1661[8],
le marchand Peron avait emprunté la somme de 2 500lt
de Théodore Cailleteau, un riche marchand rochelais. Cette somme
aurait-elle servi à financer les radoubs du navire Le Taureau et
son voyage de pêche à son retour de Québec ?
À cet effet, le samedi 18 juin[9],
le marchand Peron et le capitaine Tadourneau s’entendent sur un contrat
de charte-partie pour le retour du navire de Québec « passant sur les
battures faire la pêcherie des morues tant sur le fleuve Saint-Laurent
que sur le banc et batture », ce à quoi Fillye promet ne pas empêcher.
Le navire Le Taureau est équipé et avitaillé de toutes les choses
nécessaires tant à la navigation qu’à la pêcherie. De plus, il est
pourvu de l’artillerie et de l’armement pour sa défense et celle de
l’équipage.
Pour l’aller à Québec, le salaire des membres de l’équipage est de 40lt
chacun. Pour le retour, il est accordé au capitaine et à son équipage le
quart de toute la pêcherie, sans oublier les pots de vin à eux fournis.
Après avoir fait leurs comptes entre eux, Peron est redevable envers
Tadourneau de la somme de 350lt qu’il payera à Jeanne
Millaud, sa femme, à savoir 260lt au cours du mois
suivant, et les 90lt restantes au retour du navire à
La Rochelle.
Vers la mi-juin[10],
Médard
Chouart
Des Groseilliers, général de la flotte des Outaouais, fait charger ses
marchandises à bord du navire Le Taureau, dont du vin qu’il a
« tasté & Gousté » pour une valeur de 150lt. Il faut
croire que Chouart ait eu l’autorisation de Fillye pour ce chargement.
Le départ
Le navire Le Taureau lève l’ancre, met les voiles puis quitte La
Rochelle vers la fin du mois de juin et arrive à Québec le mercredi 24
août.
De l’équipage, nous connaissons :
-
Élie Tadourneau, capitaine
Des passagers, nous connaissons :
-
Médard Chouart Des Groseilliers
et ses
engagés :
-
Jean Crépeau (24 ans), laboureur, de Laleu
-
Antoine D’Aulnay (23 ans), laboureur, de Luçon
-
Louis Gaborit (22 ans), laboureur, de Saint-Martin-de-la-Coudre
-
Pierre Romieu (24 ans), chirurgien, de Béziers
-
René Vallet (24 ans), arquebusier, de Saumur
La flotte de 1661 à destination de Québec est composée de trois navires,
soit deux de La Rochelle et un de Dieppe. Deux navires rochelais partent
pour un voyage de pêche à l’île Percée. Ils sont :
-
La Marguerite (300 tx), de La Rochelle (capitaine Guillaume Heurtin), frétée par Pierre Gaigneur, destiné à l’île Percée;
-
La Marie (400 tx), de La Rochelle (capitaine Jacques Pingault), frétée par Guillaume Massé et associés, destinée à l’île Percée;
-
Le Saint-Pierre (300 tx), de Dieppe, frété par la Compagnie de Normandie;
-
Le Taureau (150 tx), de La Rochelle (capitaine Élie Tadourneau), frété par la Compagnie de Normandie;
-
Navire du capitaine Laurent Poulet, frété par la Compagnie de Normandie ?
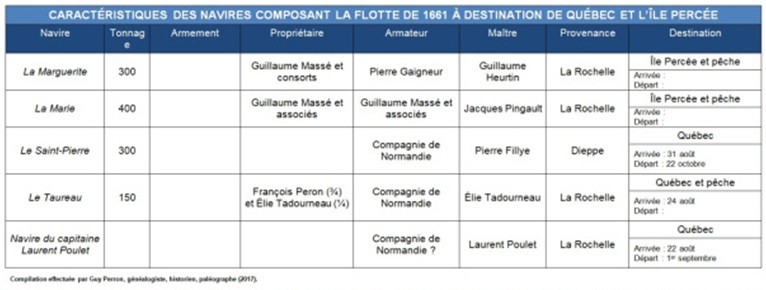
Caractéristiques des navires composant la flotte de 1661 à destination de Québec et l’île Percée.
(Source : Collection Guy Perron)
Le retour
Porteur d’une lettre de change qu’il a reçue depuis peu d’un navire
venant de Terre-Neuve, François Peron se rend au domicile du marchand
protestant Gédéon
Théroulde
(représentant de Rozée, Guenet et Compagnie à La Rochelle), situé sur la
rue Saint-Yon. Il le somme de payer, dans le cours du prochain mois, la
lettre de change qui suit.
|
A quebecq le 6e Jour de Septembre 1661 pour 4255
[livres] 10 S[ols] tournois MonSieur vous payé
Sil vous plaist par Cette premiere de change ne layant par n[ot]re
Seconde A m[onsieu]r françois
Peron ung mois apres Larrivée du Capp[itai]ne
tadourneau en la ville de la Rochelle La Somme de quatre
mil deux Cents Cinquante Cincq livres dix Sols t[ournoi]z
que nous lui Sommes demeurés redebvable en Contenu Avecq lui de
deça pour le fret de Son navire le Taureau & paSSerés Lad[ite]
Somme a Conte de m[essieu]rs J.R. Et C[ompagnie]
par advis de v[ot]re tres humble Serviteur Signé
Charles Aubert Et A CoSté A MonSieur MonSieur Gedeon Theroude
marchand a la Rochelle. |
|
Lettre de change de Charles Aubert, commis des sieurs Rozée,
Guenet et Compagnie, marchands de Rouen, à François Peron,
marchand de La Rochelle. 6 septembre 1661. |
|
Source : AD17. Notaire Abel Cherbonnier. Liasse 3 E 305 (24
novembre 1661) |
Charles Aubert, commis de Rozée, Guenet et Compagnie, est ici le tireur
qui veut passer au compte de cette Compagnie, donneur de valeur, les
4 255lt 10s avec l’ordre de payer ce
montant à François Peron, porteur, en tirant une lettre de change sur
Gédéon Théroulde, tiré.
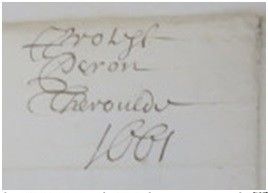 Étant à l’échéance du terme, Peron fait valoir à Théroulde que le
contrat d’affrètement et de charte-partie du 3 juin stipulait que la
somme due (restant du fret) par la Compagnie serait payée « un mois
après avoir eu la nouvelle de l’arrivée du navire Le Taureau à
Québec », bien que la lettre de change précise plutôt « un mois après
l’arrivée du capitaine Tadourneau en la ville de La Rochelle. »
Étant à l’échéance du terme, Peron fait valoir à Théroulde que le
contrat d’affrètement et de charte-partie du 3 juin stipulait que la
somme due (restant du fret) par la Compagnie serait payée « un mois
après avoir eu la nouvelle de l’arrivée du navire Le Taureau à
Québec », bien que la lettre de change précise plutôt « un mois après
l’arrivée du capitaine Tadourneau en la ville de La Rochelle. »

Charles Aubert de la Chesnaye (1632-1702)
(Source : Wikimedia Commons)
Cela est peut-être dû au fait que, selon Peron, Charles Aubert de La
Chesnaye, l’un des commis de la Compagnie, ignore les termes de la
charte-partie du 3 juin. Si Théroulde refuse d’accepter la lettre de
change, Peron prendra la même somme « à charge et recharge de son
retardement et de tous les frais, dépens, dommages et intérêts » et,
s’il le faut, se rendra lui-même à Rouen pour contraindre Rozée, Guenet
et Compagnie au paiement des 4 255lt 10s.
Quant à Théroulde, il ne peut, sur le champ, répondre rien d’autre qu’il
en donnera avis à ladite Compagnie.
Quelque temps auparavant[11],
le marchand rochelais Pierre Millereau reconnaissait avoir reçu de Peron
les sommes de 135lt 8s et 45lt
13s pour une estimation de cordage.
Pendant ce temps-là, en Nouvelle-France, le 7 novembre 1661, le roi lui
en ayant laissé la décision, le gouverneur Pierre Dubois
Davaugour met fin au monopole de la Compagnie de Normandie.
[1]
Une des raisons d’un arrêt à l’île Percée, en plus de la pêche, c’est
que ce sont des navires de fort tonnage qui n’osent pas risquer plus
avant dans le fleuve. Une chaloupe partait de Québec pour l’île et y
ramenait certains passagers qui ont fait la traversée sur l’un de ces
navires. Michel Langlois, « Liste des navires venus en Nouvelle-France
de 1657 à 1665 », L’Ancêtre, Société de généalogie de Québec,
Québec, vol. 3, no 1, septembre 1976, p. 6.
[2] Marcel Trudel,
Histoire de la Nouvelle-France, Montréal, Éditions Fides, vol. III :
La seigneurie des Cent-Associés, t. 1 : Les événements,
1979, p. 286.
[3] Création de la
« Compagnie de Normandie » qui a pour privilège de fournir pendant les
années 1660, 1661, 1662 et 1663 toutes les marchandises, provisions et
autres choses nécessaires aux habitants de la Nouvelle-France. Lionel
Laberge, Rouen et le commerce du Canada de 1650 à 1670,
L’Ange-Gardien, Éditions Bois-Lotinville, 1972, p. 69.
[4] Marcel Trudel, op.
cit., p. 285.
[5] AD17. Notaire Abel
Cherbonnier. Liasse 3 E 1128. 3 juin 1661.
[6] Une charte-partie est
un acte constituant un contrat conclu de gré à gré entre un fréteur et
un affréteur, dans lequel le fréteur met à disposition de l’affréteur un
navire. Le nom vient de ce que le document était établi en deux
exemplaires que l’on découpait par le milieu pour en remettre deux
moitiés à chaque partie. Mémoire d’un port. La Rochelle et
l’Atlantique XVIe-XIXe siècle. Musée du
Nouveau Monde, La Rochelle, 1985, p. 25.
[7] Perte ou dommage
fortuitement occasionné à un navire ou à sa cargaison (ex. : guerre,
naufrage, feu, etc.).
[8] Cette obligation ne
figure pas dans les registres du notaire Rabusson à La Rochelle.
Cependant, elle est citée dans l’inventaire des biens de Théodore
Cailleteau dans lequel il est mentionné deux quittances de 500 livres :
l’une du 8 novembre 1662, l’autre du 24 mars 1663. AD17. Notaire Pierre
Teuleron. 3 E 1353 (15 novembre 1664). C’est pourquoi il restait 1 500
livres à payer en 1667. BAnQ. Registre de la Prévôté de Québec, I, fol.
90 (29 novembre 1667).
[9] AD17. Notaire Abel
Cherbonnier. Liasse 3 E 1128 (18 juin 1661).
[10] AD17. Notaire Abel
Cherbonnier. Liasse 3 E 1128 (15 juin 1661).
[11] AD17. Fonds Amirauté
de La Rochelle. Cour ordinaire. B 201, fol. 166v (28 septembre et 7
octobre 1661).
Sur le même thème
39 - L'expédition du navire Le Thoreau pour Québec en 1663Dans
"Canada"
108 - L’expédition du navire Le Vieux Siméon pour le Canada en 1665Dans
"Canada"
152 - L’expédition du navire Le Saint-Joseph pour le Canada en 1651Dans
"Canada"
-
190 – Sépultures protestantes à La Rochelle entre 1631 et 1647 –
Lettre M
-
192 – Les engagés levés par Olivier Letardif pour le Canada en 1643
Catégories :Canada,
Engagés,
Expéditions de navires,
France,
HISTOIRE,
La Rochelle,
Nouvelle-France,
Percé,
Québec,
Terre-Neuve
Articles récents
-
201 – Sépultures protestantes à La Rochelle entre 1631 et 1647 –
Lettres S et T
-
200 – Condamnés à quitter La Rochelle entre 1647 et 1663 (2/2)
-
199 – Condamnés à quitter La Rochelle entre 1647 et 1663 (1/2)
-
198 – Sépultures protestantes à La Rochelle entre 1631 et 1647 –
Lettre R
-
Mise à jour des articles 192 et 194
-
197 – La procession du Saint-Sacrement à La Rochelle en 1638
-
196 – Sépultures protestantes à La Rochelle entre 1631 et 1647 –
Lettre P
-
195 – L’expédition du navire La Paix pour Terre-Neuve en 1663
La rochelle
La Rochelle le15 juin 1661 à bord du navire Le Taureau à
destination de Québec.
« Par ma foi, cette passerelle n’arrête pas de bouger et à chaque fois
que j’avance je glisse, j’ai les
pieds pleins de boue, ce limon collant
ramassée en traversant le chemin de la décharge jusqu’au ponton
couvert de varech. Et Cette passerelle qui n’arrête pas de monter et
descendre à chaque coup de vagues, si cela ne suffisait pas des
bourrasques de vent font s’envoler l’écume qui vient me recouvrir. Les
marins habitués à un sol mouvant n’ont pas jugé bon d’installer un
garde-corps ou un bout bien tendu. Bien sûr la dernière nuit passée avec
la jeannette m’a un peu fatigué. Mais ce n’est pas tant la jeannette
avec ces jolis tétons, que le petit blanc des dunes qui m’a donné ce
bourdonnement dans les oreilles. Quels souvenirs joyeux je garderai de
ses cheveux roux dans la paille de l’écurie. Mon sac sur les épaules
ajoute aux déséquilibres. Diables ! Cette grosse vague chargée d’écume à
bien failli me jeter à l’eau. Les oiseaux de mer mènent leurs danses
désordonnées autour de moi et ne favorise pas mon équilibre. Leur
cacophonie arrive à couvrir le bruit du ressac. Au moment de poser mon
pied sur le plat bord, le goudron répandu sur la coque me saute une
nouvelle fois aux narines. Un haut le cœur me monte à la gorge, j’ai
trop passé cette saleté sur la coque je ne supporte plus son odeur.
Heureusement que ce travail m’a occupé, il m’a procuré quelques monnaies
alors que je n’en avais plus. J’ai trouvé « Le taureau » remisé en cale
sèche après sa campagne à la morue l’an passé à terre neuve,
et il a fallu de nombreux bras pour radouber sa coque, la
calfater puis goudronner. Et après, passer de la chaux sur la totalité
de la coque intérieure des ponts aux plafonds, l’entrepont et jusqu’ au
fond de cale. Mon engagement fait avec M. Médard des groseilliers en 59,
m’a laissé sans argent dans l’attente du départ. Voilà presque deux ans
maintenant. Le capitaine m’a pris sous sa protection car il connaît bien
mon patron, ils ont fait de nombreuses campagnes ensemble et à deviné
que nous étions de la même religion. C’est lui qui m’a appris que mon
trappeur d’employeur est en désaccord avec le roi. En effet le
roi-soleil à qui a fort à faire en Europe à guerroyer pour agrandir les
frontières du royaume. A oublié ses terres du Canada en autorisant un
groupe d’investisseurs au nombre de cent associés pour développer cette
terre lointaine et y créer une nouvelle France. Mais le roi, sans doute
bien informé par le gouverneur du Québec, a senti qu’une grosse part des
bénéfices à tirer allait lui échapper. Il a donc fait main basse sur les
comptoirs commerciaux construits par les colons au prix du sang des
larmes de sueur dans une nature hostile au climat parfois impossible.
Pendant que je survis de petits boulots au port mon patron essaye de
trouver des appuis auprès des tribunaux d’abord, puis lassé, il est
passé à l’ennemi Anglais, mais cela s’est compliqué et la confiance est
encore moins possible avec ces rouges. Il ne peut se résoudre à trahir
même s’il se sent avoir été lui-même trahi. Mon contrat est préservé, et
le notaire m’a dit qu’il serait honoré, je l’ai renouvelé en 61 et je
suis prêt à repartir pour les trois ans prévus. N’ayant pas d’autre
choix que de disparaître un moment pour me faire oublier, je continue à
vouloir migrer au Canada. Il n’y a pas que cette histoire du comte et de
sa fille, je ne suis pas tout seul à être le père du batard qui a du
voir le jour depuis. Je ne pouvais de toutes les façons assumer la chose
étant donné mon rang. Vu la fortune du comte un gentilhomme ira redorer
son blason en convolant et donnera son nom au nouveau né avant de partir
au combat et laisser discrètement, madame reprendre ses chasses. La
bonne raison, Le notaire m’a affirmé que les artisans aux colonies,
s’ils étaient de toutes mains, et habiles en leurs réalisations ;
pouvaient valider plusieurs métiers dés le moment qu’ils ont satisfait
les clients. La perspective au retour de pouvoir ouvrir un atelier comme
maitre en étant affranchi des jurandes et confréries qui barraient le
passage à tous ceux qui n’avaient un nom dans la profession, fi des
dons, et divers chefs d’œuvres, et enfin des banquets coûteux, tout ça
me fera gagner du temps et de l’argent.
Presque deux ans ont passés.
|
Servitude [de René] Vallet [à Médard] Chouart.
(graphie contemporaine) |
|
Sachent tous que par-devant Pierre Moreau, notaire, tabellion
royal et garde-note héréditaire en la ville et gouvernement de
La Rochelle. Ont été présents et personnellement établis René
Vallet, arquebusier, âgé de vingt-quatre ans ou environ, du lieu
de Saumur en Anjou, d’une part. Et Médard Chouart sieur Des
Groseilliers, général de la flotte des Outaouais, demeurant aux
Trois-Rivières, pays de la Nouvelle-France, d’autre part.
Lesquels ont volontairement fait entre eux ce qui s’ensuit.
C’est à savoir que ledit Vallet s’est loué par ces présentes
audit sieur Chouart pour aller le servir, ou autres de lui ayant
charge, audit pays de la Nouvelle-France et travailler de sa
dite vacation d’arquebusier et de la forge et non à autre
besogne durant trois années prochaines, consécutives et sans
intervalle de temps qui commenceront du jour qu’il arrivera
audit pays et y mettra pied à terre. Et afin d’y aller, ledit
sieur Chouart le fera embarquer dans un vaisseau, le nourrira
durant son dit passage et desdites trois années. Et outre, lui
baillera pour ses loyers la somme de six vingt quinze livres
tournois par chacun an audit pays de la Nouvelle-France, ainsi
que chacune année échera. Sur quoi, toutefois, sera déduit et
rabattu ce que ledit sieur Chouart lui baillera en cette ville
auparavant s’embarquer. Car ainsi a été avec tout ce que dessus
stipulé et accepté par les parties chacune pour leur regard. Et
à ce faire et accomplir par elles chacune en leur endroit, sans
venir au contraire, à peine de tous dépens, dommages et
intérêts. Obligeant respectivement tous et chacun leurs biens &.
Spécialement ledit serviteur, ses dits loyers sans &. Et outre,
ledit serviteur sa personne à tenir prison comme pour deniers
royaux. Renonçant &. Promis et juré &. Jugé et condamné &. Fait
à La Rochelle dans l’étude dudit notaire après-midi, ce
vingt-septième mai mille six cents soixante-et-un. Présents le
sieur Jacques Massé, marchant, et Adrien Vanderblock, clerc,
demeurant en ladite Rochelle. En outre par les mêmes présentes X A
accordé à Christophe Gerbault, soldat de la garnison des
Trois-Rivières, à ce présent et personnellement établi, de le
recevoir à boire et manger en sa maison, avec ledit Vallet son
cousin, en apportant en ladite maison les provisions qui luy
seront données dans ladite garnison pour sa nourriture. Faict
comme dessus X Ledit sieur Chouart. Et a ledit Vallet
déclaré ne savoir signer de ce requis. Signatures. |
Mais entre la première rencontre avec le trappeur et
la signature du contrat il s’est passé bien des choses. Médard
Chouart Des Groseilliers dépossédé de ses peaux par le gouverneur du
Québec en 1660 est revenu à la cour de France plaider auprès du Roi. A
cause de cela, Il m’a un peu abandonné à moi même.
En 1659,
avec son compagnon et beau frère
Pierre-Esprit Radisson (dont
il a épousé la sœur de douze ans !), il retourne dans la région du lac
Supérieur.
À leur retour en 1660,
ils ramènent une cargaison de fourrures sur plus de deux cent canots.
Comme ils n'avaient pas de permis (ils ne savent pas que la loi a
changée depuis leur départ) pour la traite des fourrures, le gouverneur
de la Nouvelle-France Pierre
de Voyer d'Argenson leur
confisque leur butin et les soumet à l'amende. Bien sur le Roi est
gagnant, il débute dans son nouveau rôle d’administrateur à sa façon et
le gouverneur doit faire preuve d’efficacité et d’allégeance. Mais le
roi crée un mécontentement
général en désorganisant les investisseurs qui ont bien du mal à
protéger leurs comptoirs difficilement construits et parfois peu
rentables. Les pionniers ont bien souvent dépéris à s’obstiner face aux
conditions de vie pénibles. Seuls ceux ayant trouvés alliance avec les
indiens ont réussis. Le souverain redistribue les cartes alors que ses
deux prédécesseurs royaux avaient compris que l’intérêt commercial et
une certaine laxité permettrait une organisation sociétale libre,
façonnée par des données géopolitiques lointaines.
« Le
regard tourné vers les tours du port, René se remémorait les expériences
auxquelles il avait dû se soumettre pour gagner sa vie. L’engagement
contracté lui avait permis de fuir sa terre natale, et de semer ses
poursuivants. Le voyage jusqu’à la
Rochelle en utilisant la Loire et ses barques jusqu’à la mer.
Puis des bateaux de pêche le long de la cote, et enfin a bon port, il
avait pu rencontrer l’armateur. Enfin la signature du contrat devant le
notaire Abel Cherbonier, le liant au trappeur pour trois ans. La longue
attente préparant au départ, et maintenant un mélange d’angoisse face à
l’océan et la joie de vivre une aventure hors du commun.
Sans une lettre de Médard, Je
serais resté au port sans emploi, et mon nouveau patron est loin. Il a
fait savoir qu’il fallait que je l’attende au port. Alors j’ai attendu,
et l’attente coûte cher à passer, surtout dans les tripots. Le transport
et quelques frais étaient payés mais cela ne suffisait pas. Il fallut
trouver de l’emploi.
René a recontacté l’explorateur coureur des bois par le conduis du
notaire Abel Cherbonnier Cet entrepreneur
découvreur d’espaces, est arrivé a point dans son époque.
le.Médard
Chouart élevé à la ferme, dite « Les Groseilliers », sur les rives de
la Marne.
Arrivé par la grâce du ciel, en Nouvelle-France à
l'âge de 16 ans, puis le jeune Médard est reçu comme Donné (belle
formule pour dire orphelin, et adopté) par les missionnaires jésuites de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons ,il
les accompagne durant dix ans
dans leurs expéditions en Huronie (région du Lac
Huron)
durant les années
1640.
Puis il s'établit à Trois-Rivières où
il devient un coureur
des bois.
Cet aventurier de légende faisait des allers et retours entre le canada
et la France pour deux raisons ; entretenir des liens entre les
« associés » entrepreneurs Français ayant mis de grosses sommes en jeu
pour tirer profit de la découverte d’un continent et sa mise sur le
marché. Et les marchands du royaume pour vendre ses fourrures, sans
intermédiaires.
Le premier contact a eu lieu entre eux trois ans avant ; Un jour alors
que le jeune René était occupé à la forge familiale. Il aperçut un homme
d’allure impressionnante. Basané, Entièrement vêtu de peaux et de
fourrures il venait de descendre à quai d’une gabare remontant le cours
de la Loire accompagnant
ses ballots de fourrures .L’homme pour se dégourdir les jambes et
utiliser le temps qu’il fallait pour changer les chevaux de hallage ;
était entré dans l’atelier d’armurerie familiale et avait demandé le
maitre pour remplacer le chien de son fusil. Seul le fils était présent,
très vite les deux hommes ont sympathisé. Si bien qu’à la fin de la
visite le jeune apprenti savait qui demander dans le port de la
rochelle, et avait en main un parchemin signé comme viatique. Pour le
jour où il voudrait s’engager vers le Canada. Il avait passé le test en
ressoudant les morceaux et réajustant le tout en discutant. Le marchand
expert en armements a immédiatement compris le parti d’avoir avec lui,
là- bas en pays sauvage, un tel ouvrier. »
« Face à la mer, tourné vers le large, le trois mats attendait les eaux
descendantes pour partir avec la marée. Au mouillage dans l’avant-port,
car lesté par sa cargaison, il n’aurait pu sortir sans talonner la
chaussée, reliquat de la barrière bloquant le port par la mer, qu’avait
dressé M. De Richelieu lors du siège de la ville en 1628. L’ouvrage
était si bien fait qu’une partie subsistait encore. De grosses poutres
émergeaient par endroits et les bateaux les utilisaient comme bites
d’amarrages. Renée avait participé à la remise à l’eau, puis charrié
avec ses collègues d’équipage, des pavés de granit placés à fond de
cale. Le bosco m’a expliqué L’intérêt de cette cargaison. D’abord elle
était là pour apporter de la stabilité au navire. Les forçats enchainés
en avaient façonné les contours, en tapant dessus le soir après leurs
travaux du jour. Ce travail leur permettait de s’offrir une nourriture
moins mauvaise. Ce lest facile à
charger comme à décharger trouvait
à coup sûr preneur au port d’arrivée, pour la réalisation des chaussées,
qui devenaient un bourbier dés le dégel annoncé. Le gouverneur de
Québec, Bien que parcimonieux de ses devises, n’hésitait-pas à acheter
ces pavés, car leur prix de revient plus que dérisoire déchargeait les
habitants d’un travail fastidieux, la voirie. Avec ce négoce une partie
des frais du voyage était amortie sans risque de pertes car cette denrée
est impérissable, si elle ne vous entraine au fond.
Je ne regrette pas d’avoir patienté pour prendre le départ car en
participant à la restauration du navire et à son chargement je suis
devenu un membre de l’équipage. Et la solidarité à bord d’un navire
chargeant 70 personnes est indispensable. J’ai fait la rencontre d’un
arquebusier en allant négocier un chargement de sel avec le capitaine.
Il y a deux mois, de bon matin le vieux loup de mer me voyant inactif
m’a attrapé par la manche. Nous avons attelé deux chevaux à la carriole
.En chemin il m’a dit l’objet du jour. Acheter du sel pour l’emporter
comme cargaison sur le bateau. Destination Brouage, une ville réputée
pour cela. A peine arrivé dans le premier bourg au sud, du port, il
fallait traverser un cours d’eau important et le passeur se faisait
attendre. Sur la berge une grande barque Platte bien grée était
commandée par un ancien second de l’armement, il reconnu son capitaine
Tadourneau. Il nous chargea car nos destinations étaient les mêmes. Son
bateau était capable de transporter des charges sur les rivières
littorales pour remonter jusqu’aux premiers ports fluviaux puis de
caboter d’un port littoral à l’autre. La forme de la coque était plate
plus large que les gabarres, elle possédait une voile carrée et pouvait
aussi gréer une voile latine. L’équipage de deux hommes et un capitaine
pouvait s’étoffer au besoin. Une espingole placée sur sa broche à
l’avant et une à l’arriére, montraient par leur présence que parfois la
force était nécessaire. La
Platte était vide et notre équipage pris place au centre. Le vent était
favorable et moins de trois heures après les murailles du fort,
devenaient visibles .Un trait blanc souligné de rose au milieu des
marais avec des petites tours en poivrières comme des pointillés sur les
angles. Quelques cheminées fumaient ; témoins d’une petite activité
industrielle. En plus du sel, et des huitres cultivées ici, le poste
servait de réserve d’armement. Le vent du large poussa la plate, en
remontant un canal entretenu pour que l’eau entoure la place au pieds
des murailles, et sous les portes a pont levis de la ville fortifiée. Un
quai d’appontement maçonné dans le mur d’enceinte comme une grotte de
pierres très bien ajustées à la façon de Vauban, permettait aux bateaux
à fond plat de toucher le bord à la gaffe et à l’aviron, pour échanger
les charges.
Un cri me fait sursauter et revenir ici, sortant de mes souvenirs.
Sur le pont, Joël le mousse
me dit d’accélérer la traversée car derrière lui le colosse, p’tit Louis
attend pour s’engager à son tour en portant un coffre lourd sur ses
épaules contenant mes outils d’arquebusier. Le capitaine
Élie Tadourneau, est placé
à côté du timonier, il lève son bras pour désigner aux marins placés
dans la mature de libérer la grand-voile d’artimon et de misaine. Au
moment où René met le pied sur le pont la grand-voile se déroule en
claquant. Il ne restait plus rien à embarquer, l’équipage est au complet
chacun à son poste, ainsi que les passagers groupés sur le pont.
J’ai reconnu le neveu
daniel Soullard
arquebusier que j’ai rencontré à Brouage Il est sommé de quitter la
région par le juge pour des raisons obscures. La vrai raison étant de
spolier les protestants.
« Condamné de vider cette ville et faubourgs par Messieurs les
commissaires de police pour s’y être habitué contre et au préjudice de
la déclaration de 1628 depuis 1647 »
aussi, il va rejoindre son oncle qui a fuit les persécutions, il est
déjà bien installé là-bas. Un cousin de Champlain l’accompagne, lui
aussi m’a été présenté, il parait que c’est son aïeul né à Brouage qui a
fondé Québec.
Quelques gars me font signe discrètement car leur attention est
entièrement orientée à la manœuvre.
Le capitaine les mains sur la barre à roue, d’un coup de menton, regarde
le quartier-maître droit dans les yeux, il donne ainsi
le signal pour appareiller, les
deux hommes se connaissent depuis des années. Un long coup de sifflet
modulé, et le chanteur attaque « la fille du président », les paroles
amusent le monde. « qui échappant lan lan …à sa surveillance,…lan
léreuuu… mis les pieds sur l’ bâtiment lan lan lan…. pour voir un marin
joli, puis pour un tour du monde, elle est partie …», un bon chanteur
vaut dix hommes d’équipages m’a ton dit. Celui-ci est Le chant préféré
de l’équipage lorsqu’il s’agissait de réaliser la manœuvre pour quitter
le mouillage. Le rythme de ce branle est saccadé et rapide, les
guindeaux, les chaines claquettent, chacun reprend une strophe en
braillant quand son tour arrive d’effectuer les gestes répétés, mesurés
par une pratique réglée par l’habitude. Les voiles l’une après l’autre
se déroulent avant que la brise ne les fasse gonfler. Le cap est mis
entre les deux îles, dans le pertuis, Ré à tribord et Oléron a bâbord, à
la hauteur de la pointe de chassiron le capitaine s’oriente au
nord-ouest. Le bateau prend de la gîte sur bâbord, arrête un moment de
rouler, pour glisser comme sur un rail vers son destin. »
Le Taureau : flûte de 150 tonneaux.
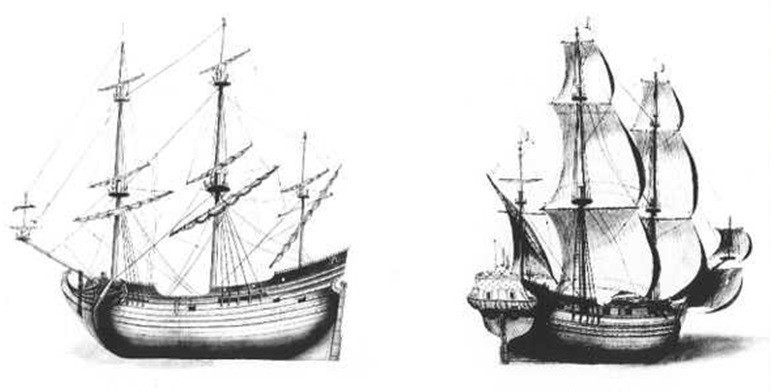
François Peron (1615-1665)
Marchand-engagiste, bourgeois et avitailleur de La Rochelle possède les trois quarts du navire et le capitaine Élie Tadourneau possède l'autre quart. Ce fier navire prend la mer En 1661, pour le Canada avec 70 passagers à son bord. Il a effectué déjà de nombreuses missions. Il fait partie de la flotte Peron composée de quatre navires. Il est l’un des plus gros navires du port de La Rochelle. Ses formes rondes sont dues au savoir-faire des Pays-Bas. Les plus gros navires de la côte ouest notamment Bordeaux à cette époque sont confiés au savoir-faire de la hollande. Les qualités réunies de leurs constructions marines sont alors reconnues. Les relations commerciales entretenues avec cette République de marchands sont indispensables dans la maîtrise de la mer et avec elle les conquêtes territoriales. Le Roi-soleil n’a pas encore jeté son dévolu sur cette province, et l’entente est cordiale. La tradition huguenote de la ville, même après la révocation et le siège de la ville, fait que des alliances inter cités existent toujours. Les protestant ont encore leurs réseaux, industrieux, fiables et opiniâtres, ils se font plus discrets, notre armateur ainsi que le capitaine en sont. Les migrants aussi. Pour les jésuites qui participent financièrement mais en dessous, tous sont des aventuriers, point de soucis, ils ont compris leurs intérêts.
« Pour moi, je suis né dans une ville ou la religion réformée est
majoritaire et ma famille à adopté les us et coutumes de la société dans
laquelle elle vit ; Mais je dois admettre que Eli à tout de suite
remarqué que j’en faisais parti, et bien que je sois loin de ces
pratiques réformées, je ne l’ai jamais découragé dans ce sens.
Sur le pont, Je me range prés de mes confrères arquebusiers, et salue le
platineur de Tulle. Il embarque avec des caisses de fusils
« boucanier », ce sont des longs fusils dont la platine est à silex
.Productions de bas de gamme mais suffisamment solide pour la traite des
peaux et la bataille contre les Iroquois alliés des anglais. Nos alliés
indiens les apprécient comme cadeaux, et il faut entretenir l’amitié ;
ce qu’ils apprécient aussi c’est d’avoir un platineur dans les forts
pour réparer leurs fusils, d’où la présence de mon confrère. Il m’a
expliqué hier dans la taverne que Monsieur de Champlain avait occis deux
chefs Iroquois d’un seul coup de ces fusils, car là-bas il est coutume
de charger à mitraille avec des balles sous calibrées. Un coup de chance
et deux ennemis sont tombés et en plus des chefs. Nos alliés indiens qui
se battent depuis toujours contre les Iroquois ont aussitôt chargés nos
fusils de pouvoirs magiques et depuis en posséder un, équivaut pour eux,
à manier la foudre. Il y a aussi un gars que l’on appelle « Bandiat
belle lame »,il est coutelier et amène avec son savoir faire ,des
« grosses »ce qui fait douze douzaines, de lames de faux ,des lames de
sabres à élaguer, des dagues à emmancher sur les fusils pour en faire
des piques appelées baïonnettes, et des couteaux. Le tout enfermé dans
des tonneaux enduits de suif. Employé dans une fabrique il a réussi à
forger pour lui en secret ces pièces une à une attendant son heure pour
gagner sa liberté. Il a déjà le mal du pays et ne cesse de parler de ce
cours d’eau Le Bandiat qui disparait pour se perdre dans le sol après le
château de Larochefoucaud, et resurgir un peu plus loin pour s’associer
avec un autre .En amont depuis le Limousin, le long de ce cours d’eau
,les moulins s’activent à transformer la production des très nombreuses
forges de sa vallée. Sa rivière se jette quand il pleut beaucoup et
qu’il y a assez d’eau, dans la Charente, c’est la route des canons de
nos navires, fabriqués tout au long. Lui a pu suivre son cours jusque
là, sur une gabarre transportant du vin, qu’il a pris à Angoulême. Le
gars de Tulle, Pauphile, me présente un pays qui à embarqué hier dans la
nuit avec sa cargaison de clous forgés sur le plateau marchois. Lui
aussi à suivi les eaux mais son bassin et sa rivière est la Vézère. Sous
l’artimon, Le chanteur à pris son fifre car maintenant la manœuvre est
finie, rien d’autre ne se prépare. Son morceau parle de bergères de
moutons et de landes balayées par le vent. Cette chanson le marchois la
connait bien. Nous écoutons tous la mélodie, et le mousse se met à
chanter les paroles, comme on dit un ange passe. Pour ne pas sombrer
dans la mélancolie, et pour faire plus ample connaissance il nous
raconte son chemin. En charriot jusqu'à Uzerche, cité formidable
fortifiée sur son éperon rocheux, puis en barque jusqu’à Allassac, grâce
aux prouesses du navetteur et aux prix de quelques portages, et enfin au
confluent avec la Corrèze sur une gabarre petite et étroite mais allant
bon train. Les eaux étaient « marchandes » pour dire que la rivière
était grasse. A saint Léon puissamment défendu par des castels murés et
des donjons étroit surveillant le port, des gabarres plus grosses
recevaient entre autre chose des canons pour Bordeaux. J’ai embarqué
avec mes caisses pour le grand port, le prix du transport je l’ai
négocié avec le patron pour une caisse de grands clous. Ils sont utiles
pour la construction de sa prochaine embarcation car il m’a apprit que
dés l’arrivée elle serait démantelée pour servir de bois d’œuvre au
port. Cela évitait aussi de la remonter au départ. J’ai bien cru ma
dernière heure arrivée quand notre bateau a rejoint la Dordogne. Ce jour
là un train de gabarres venues sur le fleuve en file ne voulaient pas se
désunir .La première en tête était énorme, chargée et avait mis une
voile carré car le vent d’auvergne lui poussait au cul. Il ne fallait
pas contrarier cette caravane .Les navigateurs du fleuve détestaient les
limousins, autant parce que leur patois ne leur convenait pas que leurs
bateaux étaient plus étroits et aussi qu’ils étaient concurrents et
qu’ils pissaient dans leur fleuve. Bon, lancés par le flot notre
capitaine et les marins ont mis les avirons en travers a tribord pour
faire déraper notre engin. Les gaffes levées des « ennemis »espéraient
nous voir venir à leur portée. Quelques injures furent échangées, nous
avons frotté un banc de sable et repris notre route en laissant le
convoi nous précéder. L’équipage respirait mieux, Combien de fois en cet
endroit il y avait eu des abordages funestes, les embarqués ne sachant
pour ainsi dire pas nager. Trois jours après, la gabarre arrivait au
confluent avec la Garonne. Mais Un peu avant trois grosses vagues nous
sont arrivées dessus venant de la mer, heureusement le capitaine
connaissait cet obstacle naturel et il nous a mis a l’abri dans le
renfoncement d’un coude pour laisser passer cette furie qui grondait. La
partie de l’estuaire est
réservée aux seuls capitaines ayant été reconnus pour pouvoir naviguer
dans cette partie et les navires sont différents et il fallut décharger
encore pour trouver une barge et aller jusqu’aux quais encombrés de
nombreux trois mats et de multiple barques de service. Là j’ai trouvé
enfin un cotre bien armé pour faire face aux corsaires présent parfois
dans l’embouchure de l’estuaire, sa destination était La rochelle. Je ne
voulais pas embarquer pour Québec depuis Bordeaux car ils n’ont pas la
destination directe, et on m’a dit du bien de l’armement Péron qui
emporte les fabrications de Tulle.
Le second vient nous trouver pour nous designer nos couchettes dans
l’entrepont. Nous aurons des hamacs à l’avant. C’est mieux que dans
l’étage du dessous car au moins on a de la lumière et un peu d’air. Ma
caisse est sanglée aux anneaux et en cas de gros temps elle ne bougera
pas. J’ai pris ce qu’il fallait de limes diverses pour attaquer un
travail dés le pied sur terre. J’ai hâte de démontrer mon savoir faire
pour enfin représenter ma corporation dont je suis fier. Le jeune
Soullard va me présenter à son oncle qui à un bel atelier m’a-t-il dit.
A moins que le trappeur me retrouve et m’assigne un lieu et une tâche
précise, ce qui m’étonnerai car je n’ai pas encore pu lui parler ; Il
s’enferme dans la cabine du capitaine avec lequel il parle sans cesse ou
partage de longues parties du jeu d’échec.bon sang, dés que je suis
enfermé j’ai des nausées, je remonte sur le pont. »
Formation du convoi :Elle a eu lieu au large des sables d’Olonne ,nos
amis venus de Bretagne attendaient et dés que nos voiles furent en vue
ils partirent au portant toutes voiles dehors pour former le convoi.
J’ai enfin dormi au bout de deux jours à vomir par-dessus bord, on
dirait que mon corps s’adapte à la mer. Le vent à tourné et je regarde
les gars grimper dans les haubans, ferler certaines voiles et rouler le
plus haute car l’air fraichi et devient plus humide, le capitaine m’a
dit que le grain arrive. Mais il est dans notre sens déplacement,
adonnant comme il dit. Il fait arrimer tout ce qui est susceptible de
bouger, notamment les canons. Il me dit que c’est comme ça que son
second, le patron de la plate qui nous a chargés pour Brouage, a perdu
sa jambe prise et écrasée entre un canon qui roulait bord sur bord et le
grand mat.
Voilà deux jours que ça tape dans la vague, le bâtiment est couché sur
tribord. On alterne un glissement rapide puis l’avant plonge en lançant
une grande giclée qui recouvre tout. L’eau pénètre parfois par les
panneaux et les interstices. On se relaye aux pompes et la peur nous
fait oublier la fatigue et les mouvements des murs et des planchers. A
l’aube du quatrième enfin, le navire se redresse, le vent se calme, le
soleil revient. Tout le monde sur le pont se relâche .le capitaine fait
mettre en perce un petit tonneau de tafia pour fêter ce coup de chien.
On fait l’inventaire des dégâts ; et rien de grave, enfin presque, notre
figure de proue a été endommagée par la chaine de ‘l’ancre qui à dérapé
et emporté la moitié du tronc et de la tête. Notre taureau est un
demi-taureau, notre capitaine semble affecté car les marins sont
superstitieux. Je vais le trouver .Capitaine, si votre charpentier me
trouve le bois dans les réserves je veux bien refaire ce qui manque à la
bestiole. J’ai pris dans ma caisse les outils pour faire les crosses de
fusil, donc je devrai y arriver. Le chef se mit à danser la gigue alors
que personne ne s’y attendait. Tope là l’arquebusier, tâche d’y refaire
le museau encore plus beau qu’avant. Le jour qui ai suivi-j’ai dégrossi
avec l’aide du charpentier, ce qu’il fallait pour replacer une ébauche
de tronc de bras et de visage. Fait les entures, mais accroché à un
filin les pieds dans la bannette à l’avant, pas envi de finir dans un
cachalot. Chevillé ces morceaux encollés à la colle de peau que le
cuistot gardait au chaud dans la cambuse. Les jours d’après à la gouge
et à la râpe sculpté les pièces et fini à la peau de raie pour adoucir
les trait. Le mousse est descendu avec une peinture que lui a préparé le
cuistot mélange d’œuf de sang de chaud et de colle, ce qui a donné un
blanc un rouge et un jaune, le noir un peu de bitume à calfater. Le
maquillage est réussi, tout le monde a dansé sur le pont en chantant
« la marie-jeanne aux beaux jambons ».Je dois dire que ces jours de
sculpture, furent les meilleurs moments du voyage, car je n’ai pas vu le
temps passer.
Deux mois environ et les oiseaux de terre font enfin une visite au
garçon dans le panier en haut du grand mat. Terre en vue ! Le violon du
chanteur entonna un air de sa composition. Un jet d’eau à l’avant, une
baleine, la queue d’une autre juste derrière. Plus tard des dauphins
joyeux. Que cela sentait bon, et en fait l’odeur des bois et le l’herbe
arriva jusqu'à nous au moment ou la première ile fut a portée de canon.
Pas d’habitants aucun signal, le capitaine navigua au nord ouest pour
trouver la cote. Il veut passer entre le port aux basques de
saint-pierre et Miquelon au nord et le cap breton de la nouvelle Ecosse
ou de l’acadie au sud comme a préféré l’appeler le capitaine. Mieux vaut
éviter cette terre car elle n’est pas sure en ce moment, et on ne sait
jamais pour qui ou quoi les hommes se battent entre eux, mais ils se
battent. »
On a croisé de nombreux navire de pèche remplissant leurs calles de morue ou traquant la baleine. Evité des plus gros ne sachant si ils étaient amis ou ennemis.